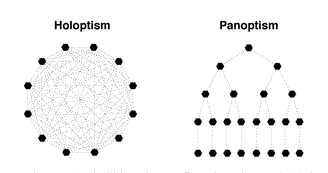Jeu de la co-perception [1]
QU’EST-CE QU’UN OBJET-LIEN ? / QU’EST-CE QU’UN OBJET-ART ?
« Les joueurs font du ballon à la fois un index tournant entre les sujets individuels, un vecteur qui permet à chacun de désigner
chacun, et l’objet principal, le lien dynamique du sujet collectif. On considérera le ballon comme un prototype de l’objet-lien,
de l’objet catalyseur d’intelligence collective » [Pierre Lévy, Philosophe et sociologue, 1994, L’intelligence collective].
Les objets-liens sont des objets –matériels ou symboliques– collectivement poursuivis. On en distingue 3 catégories :
Plus précisément, qu’est-ce qu’un OBJET-ART ?
Alors que les objets-proies et les objets-ennemis sont donnés par réaction, les objets-arts sont issus de la création.
Projections du désir dans le temps, ils sont des horizons qui orientent nos pas et sur des sols qui se déroulent devant nous.
Destinés à faire le monde, sans cesse ils se réinventent, se réactualisent, se réincarnent, nourris pas leur propre nature créatrice.
- Objets-arts statiques : les aspirations, intentions et projets [autres que la survivance], les modèles, plans d’action, mélodies, etc.
- Objets-arts émergents : outils de représentation collective, sans cesse réactualisés par la somme des interactions individuelles,
ce sont les nouveaux objets-arts de l’holoptisme*, des intégrations dynamiques de savoirs collectifs, des arbres de connaissance.
LES OBJETS-PROIES
Ce sont des "tous pour un" :
objets d’attraction que l’on
veut conquérir, attraper et incorporer à soi, souvent en contexte de compétition
du fait de leur rareté.
Exemples :
l’argent, le pouvoir,
la propriété, le temps,
la notoriété, l’estime, etc.
LES OBJETS-ENNEMIS
Ce sont des "tous contre un" :
objets de répulsion vers
lesquels des individualités
ou des populations
se soudent contre.
Exemples :
l’ennemi, le danger,
la maladie, la sorcière,
le communiste, le juif,
la femme, l’homosexuel,
l’étranger, le terroriste, etc.
LES OBJETS-ARTS
Ce sont des "tous pour tous" :
ils relient nos intériorités
les unes aux autres et
construisent le monde.
Exemples :
un modèle idéal, les lois du
vivant, les droits et les devoirs
de l’humain, les œuvres d’art,
les valeurs et les principes philosophiques, l’idée
du bonheur, etc.
* HOLOPTISME :
Un espace holoptique est un espace physique dont l’architecture est intentionnellement conçue
pour donner à ses acteurs la faculté de percevoir en temps réel l’ensemble de ce qui s’y déroule.
En cet espace, d’une part il y a TRANSPARENCE HORIZONTALE ET VERTICALE : perception des
manifestations de tous les participants, et aussi perception de la manifestation émergente du groupe,
c’est-à-dire du « Tout émergent » du collectif [=niveau supérieur, qui transcende et inclut sans aliéner les
sous-systèmes du niveau de complexité inférieur] ; ici chacun-e a une vision de soi, des autres et du Tout.
D’autre part, il y a COMMUNICATION HORIZONTALE ET VERTICALE : possibilité d’engager une relation
dynamique entre le niveau individuel et le niveau collectif [= « Tout émergent », collectif en devenir] ;
ici tous les échanges, de même que toutes les "ressources", sont perceptibles et accessibles.
Exemples de situations qui présentent des conditions holoptiques : une équipe de sport,
un groupe de jazz, un rassemblement en cercle avec un nombre limité de participants...
L’holoptisme est une des propriétés qui apparaît dans des petits groupes [comme dans les
tribus nomades durant le paléolithique] et il implique la possibilité pour tout membre du groupe
à pouvoir appréhender la totalité du groupe et de son activité. Ainsi, chacun-e peut adapter son
comportement en fonction des autres et du « Tout émergent », c’est-à-dire du collectif en devenir.
Au contraire, le panoptisme est une propriété qui apparaît au sein des grands groupes et qui est
typiquement associé aux structures pyramidales. Dans un système panoptique, chaque membre
n’a qu’une vision restreinte du Tout et l’information converge vers un point central, bien souvent
vers le haut de la hiérarchie. Tels les grimpeurs d’une montagne, chaque grimpeur n’a qu’une
vision partielle de l’ensemble, où qu’il soit mené dans son ascension. Celui qui est parvenu
au sommet peut voir toute la montagne si son regard balaie à 360 degrés, mais il ne peut
accéder aux détails. Celui d’en bas voit le détail d’une partie du bas, celui du milieu voit
le détail d’une partie du milieu, mais aucun d’eux ne perçoit distinctement le sommet.
––––––––––––––––